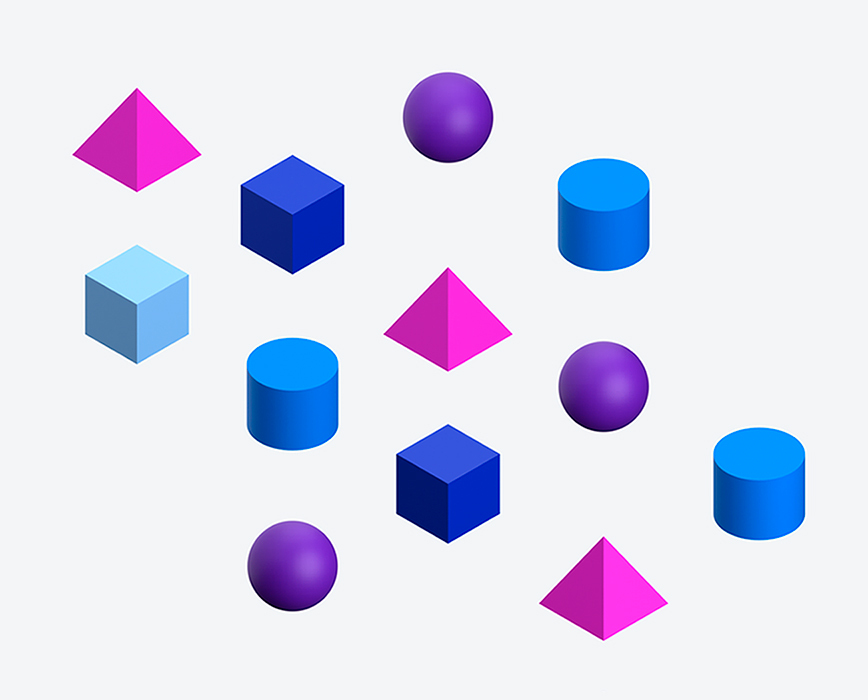Un tournant : Pourquoi le risque physique exige désormais l’attention des investisseurs
L’essoufflement de la transition climatique attire davantage l’attention des investisseurs sur les risques physiques
Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les investisseurs avaient de nombreuses raisons d’accorder la priorité au risque de transition. Un contexte politique clair et des signaux forts du marché – ancrés par l’Accord de Paris et renforcés à la COP26 – ont fait en sorte qu’il était logique de supposer que la valeur des actifs serait remodelée par des stratégies ambitieuses de réduction des émissions et un objectif de limitation du réchauffement à 1,5 °C (2,7 °F). Cet accord mondial, ainsi que les engagements prospectifs des gouvernements et des entreprises, a laissé penser que l’incidence financière du risque de transition se concrétiserait plus rapidement et plus fortement que le risque physique.
Cette thèse s’est affaiblie. Au cours de la dernière année, les victoires populistes dans certaines des plus grandes économies du monde ont permis à des dirigeants de mettre en place des programmes climatiques rétrogrades. En effet, le dernier rapport des Nations Unies sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions prévoit que les politiques actuelles pourraient entraîner un réchauffement de 3,1 °C (5,58 °F) d’ici la fin du siècle. L’Union européenne a suspendu la rédaction de nouveaux rapports sur le développement durable et les prix du carbone en Europe demeurent bien en deçà de leurs sommets récents. Les entreprises ont également marqué le pas. Une grande partie de la demande en énergie verte sert désormais à alimenter les centres de données plutôt qu’à les combustibles fossiles.
Par ailleurs, les répercussions physiques des changements climatiques (feux de forêt, inondations et tempêtes) ne font qu’augmenter en coût et en fréquence. Les pertes ont dépassé les 400 milliards de dollars américains en 2024, les dommages causés par les inondations et les feux de forêt ayant atteint de nouveaux records. La Grèce a connu sa saison de feux de forêt la plus intense jamais enregistrée, et la chaleur extrême en Asie du Sud a provoqué des pannes d’électricité, des mauvaises récoltes et des effets généralisés sur la santé. Ces événements se révèlent plus graves et plus généralisés que prévu, ce qui incite les investisseurs à réévaluer si le risque physique se concrétisera plus tôt et avec plus d’intensité et de persistance que prévu.
À mesure que les dommages augmentent, les marchés de l’assurance réagissent : hausse des primes, durcissement des conditions et, dans certains cas, retrait de la couverture. Pour les investisseurs, ce changement ne se limite pas à une question de coûts; il s’agit d’un signal précoce du marché indiquant une exposition non traitée. Il sera de plus en plus difficile d’assurer les actifs qui ne sont pas assortis de mesures d’adaptation adéquates. À l’inverse, les prix à terme de l’assurance (s’ils étaient plus facilement accessibles) pourraient aider à évaluer le risque physique et les avantages d’investir dans la résilience, en montrant comment les mesures de protection actuelles peuvent protéger les entreprises contre les hausses de coûts futures et contribuer à préserver la valeur de l’actif à long terme. Fait crucial, même si l’assurance peut signaler et transférer le risque financier, elle ne réduit pas la vulnérabilité physique sous-jacente : la véritable résilience dépend de la capacité de l’actif à résister aux impacts liés au climat.
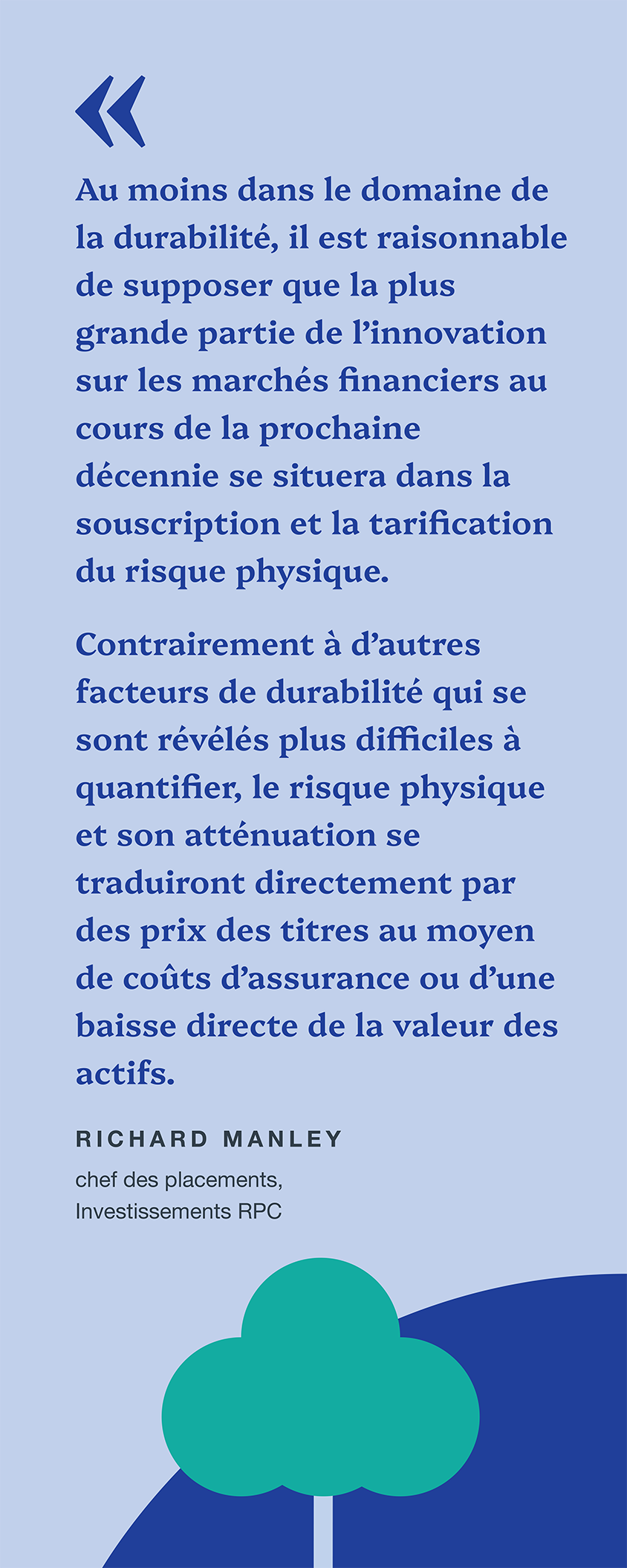
En termes simples, peu de défis en matière de souscription auxquels font face les investisseurs aujourd’hui évoluent aussi rapidement ou avec plus de conséquences.
Le présent document décrit comment cinq grands fonds publics de placement, définis ici par les investisseurs institutionnels à long terme soutenus par le gouvernement, y compris les caisses de retraite publiques et les fonds souverains, commencent à intégrer le risque physique à leurs processus de placement. Ces fonds, qui gèrent collectivement un actif d’environ 2 700 milliards de dollars américains, ont fait part de leurs points de vue sur les divers obstacles auxquels ils sont confrontés, les données qu’ils utilisent actuellement et les leçons qu’ils ont tirées. Il en résulte une vision préliminaire consolidée des approches émergentes en matière d’intégration du risque physique – pas une seule étude de cas, mais une perspective combinée sur ce qui sera nécessaire pour mieux atténuer le risque.
Pour être clair, ce document représente un instantané à un instant précis. La compréhension des investisseurs des répercussions du risque physique sur le portefeuille progresse rapidement, tout comme les techniques et les technologies de gestion de ce risque. Dans cinq ans, les approches de ces institutions seront probablement très différentes.
Néanmoins, pour les investisseurs, comprendre où en sont les choses aujourd’hui est une première étape essentielle pour bâtir des stratégies de placement plus résilientes. Pour les entreprises, les mêmes perspectives peuvent servir de signal sur le marché, en clarifiant ce qui est nécessaire pour améliorer la stabilité des placements à long terme et attirer des capitaux. De façon plus générale, l’amélioration de la compréhension et de la gestion du risque physique peut améliorer l’ensemble de l’écosystème de placement, ce qui permet une meilleure répartition du capital, un engagement plus éclairé et de meilleurs résultats à long terme pour tous les participants du marché.
Définition du risque physique
Les fonds publics auxquels nous avons parlé ont défini le risque physique comme le potentiel de perte financière en raison d’événements liés au climat. Il peut être divisé en deux catégories : les risques chroniques, qui se développent graduellement au fil du temps (comme la hausse du niveau de la mer ou la hausse des températures), et les risques aigus, qui découlent de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations, les feux de forêt ou les ouragans. Les risques physiques sont reconnus comme une certitude, ce qui signifie qu’ils vont se produire, quelle que soit la situation climatique, et se manifesteront même dans un scénario de réchauffement de 1,5 °C (2,7 °F).1 Le Potsdam Institute for Climate Impact Research a constaté que, même si les émissions de CO2 sont considérablement réduites à compter d’aujourd’hui, l’économie mondiale devrait déjà connaître une baisse de revenus de 19 % d’ici 2050 en raison des changements climatiques.2 La question n’est pas de savoir si les risques physiques se manifesteront, mais quand, dans quelle mesure et à quelle fréquence.
Un fonds a souligné que l’exposition aux risques chroniques est la plus importante selon une approche descendante d’une répartition stratégique de l’actif, soulignant « l’incapacité des marchés financiers à évaluer adéquatement les risques systémiques et chroniques associés aux changements climatiques à long terme. » Ceux-ci incluent la migration climatique à grande échelle et les mauvaises récoltes qui s’enchaînent, mais il y en a d’autres. L’exposition aux risques physiques aigus est plus importante dans les secteurs de l’immobilier et des infrastructures qui sont les composantes essentielles des actifs immobiliers, mais elle s’étend également à l’ensemble du portefeuille et touche un éventail de catégories d’actifs, y compris les obligations et les actions cotées en bourse.
La nature à long terme des placements détenus par ces fonds publics amplifie l’exposition aux risques aigus et chroniques, en particulier dans les infrastructures où les dégâts peuvent avoir une incidence directe sur les flux de trésorerie et la valeur des actifs. De plus, les risques physiques peuvent toucher les chaînes d’approvisionnement et les conditions macroéconomiques en général, , ce qui a une répercussion indirecte sur les prix des actifs.
Méthodes et cadres d’évaluation
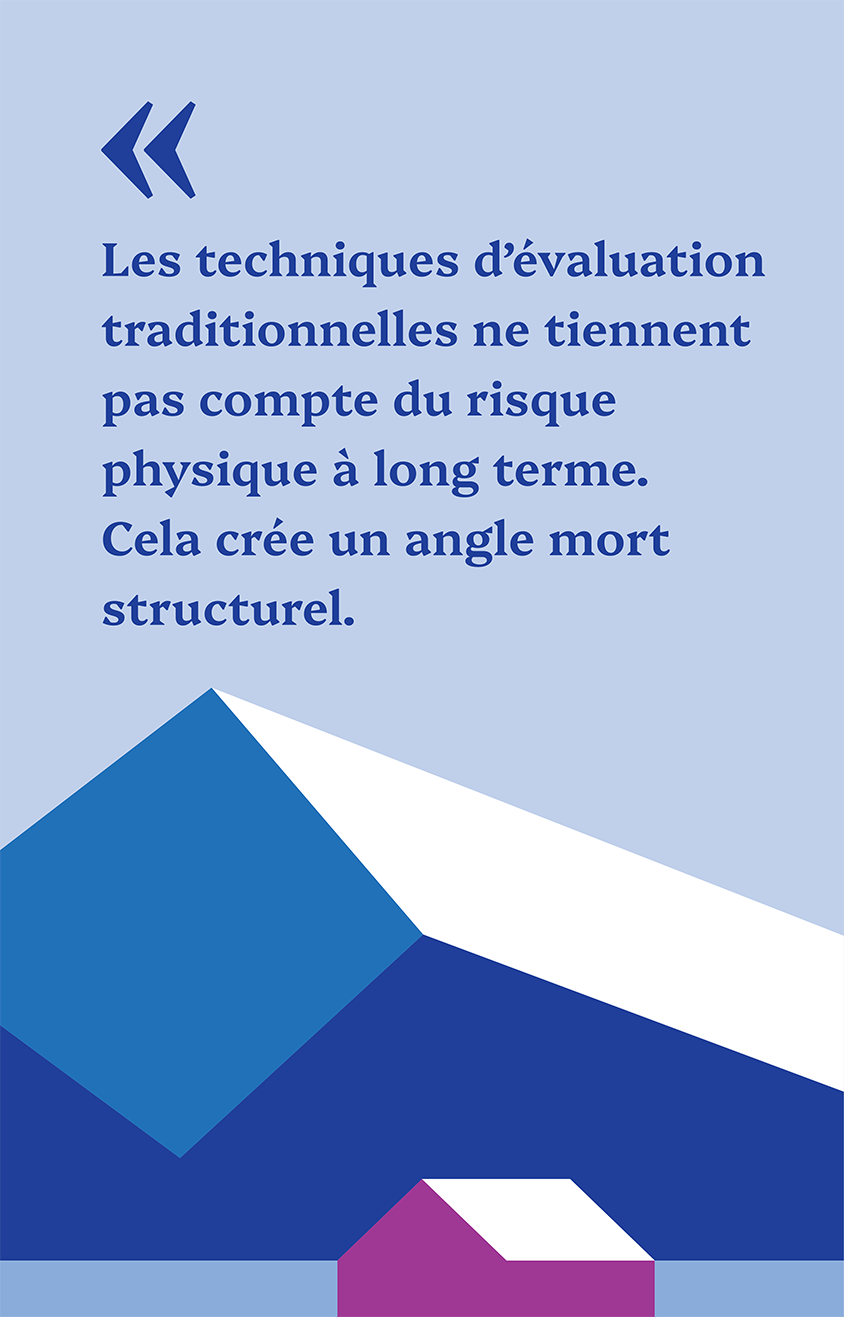
Les fonds publics emploient diverses méthodes pour évaluer les risques physiques, combinant une analyse macroéconomique descendante et des évaluations des actifs ascendantes. Une approche commune parmi les fonds interrogés est l’utilisation de l’analyse de scénarios pour comprendre les impacts potentiels et l’exposition des actifs selon différentes trajectoires climatiques. L’analyse des scénarios climatiques sert à évaluer l’incidence des changements macroéconomiques sur le portefeuille, en examinant les répercussions du PIB et de l’inflation au moyen de modèles, comme les résultats des scénarios de transition du National Institute Global Economic Model (NiGEM), le Network for Greening the Financial System (NGFS) ou le cadre de la MSCI Climate Value-at-Risk.
Les fonds testent des approches pour soutenir la sélection précoce du risque dans les transactions afin de mieux « intégrer les répercussions financières dans la souscription de base et d’effectuer des évaluations plus approfondies du risque indirect. » Il s’agit notamment de fonctions de dommages à haute résolution ou de modèles qui fournissent une estimation des dommages causés à certains actifs par divers facteurs, y compris des phénomènes météorologiques extrêmes. Ceux-ci tiennent compte des caractéristiques des actifs, comme l’âge, le matériel et l’emplacement, ainsi que des risques externes, comme les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. De nombreux fonds publics collaborent également avec des fournisseurs externes pour affiner leurs modèles de risque.
Malgré cela, il reste difficile d’assurer l’exactitude de ces modèles. La plupart des modèles ont du mal à traduire les changements de fréquence et de gravité des événements climatiques en une valeur monétaire des dommages. Par conséquent, les fonds publics reconnaissent que, même si les modèles aident à identifier les principales concentrations de risque, ils ne peuvent pas encore fournir des prévisions précises de l’incidence financière.
De plus, un fonds a fait remarquer que les risques physiques sont actuellement sous-estimés et mal évalués sur le marché. « Cette approche entraîne une perte de 2 % du portefeuille d’actions en 2080, ce qui n’est tout simplement pas réaliste. » Le fonds applique donc sa propre approche « descendante », en examinant l’incidence du climat sur le PIB et les économies, ainsi que la façon dont les entreprises sont exposées. Cela a révélé une « perte de 19 % sur le portefeuille d’actions aux États-Unis, contre 2 %. » Néanmoins, le fonds a reconnu « qu’il sous-estimait toujours les points de basculement, les dommages chroniques et la migration. » En particulier, l’hypothèse sous-jacente des modèles est que la capacité du marché de l’assurance augmentera pour répondre à la demande croissante de transfert de risque. Toutefois, une réévaluation importante des primes d’assurance pour tenir compte de la probabilité croissante de dommages – ou de la perte totale de l’accès à la couverture – pourrait faire en sorte que les risques physiques liés au climat soient pris en compte dans les titres bien avant que les pertes réelles ne se concrétisent. De plus, les modèles actuels sous-pondèrent souvent les impacts en cascade, comme la migration causée par le climat et le potentiel d’instabilité politique ou économique connexe.
Obstacles à l’intégration
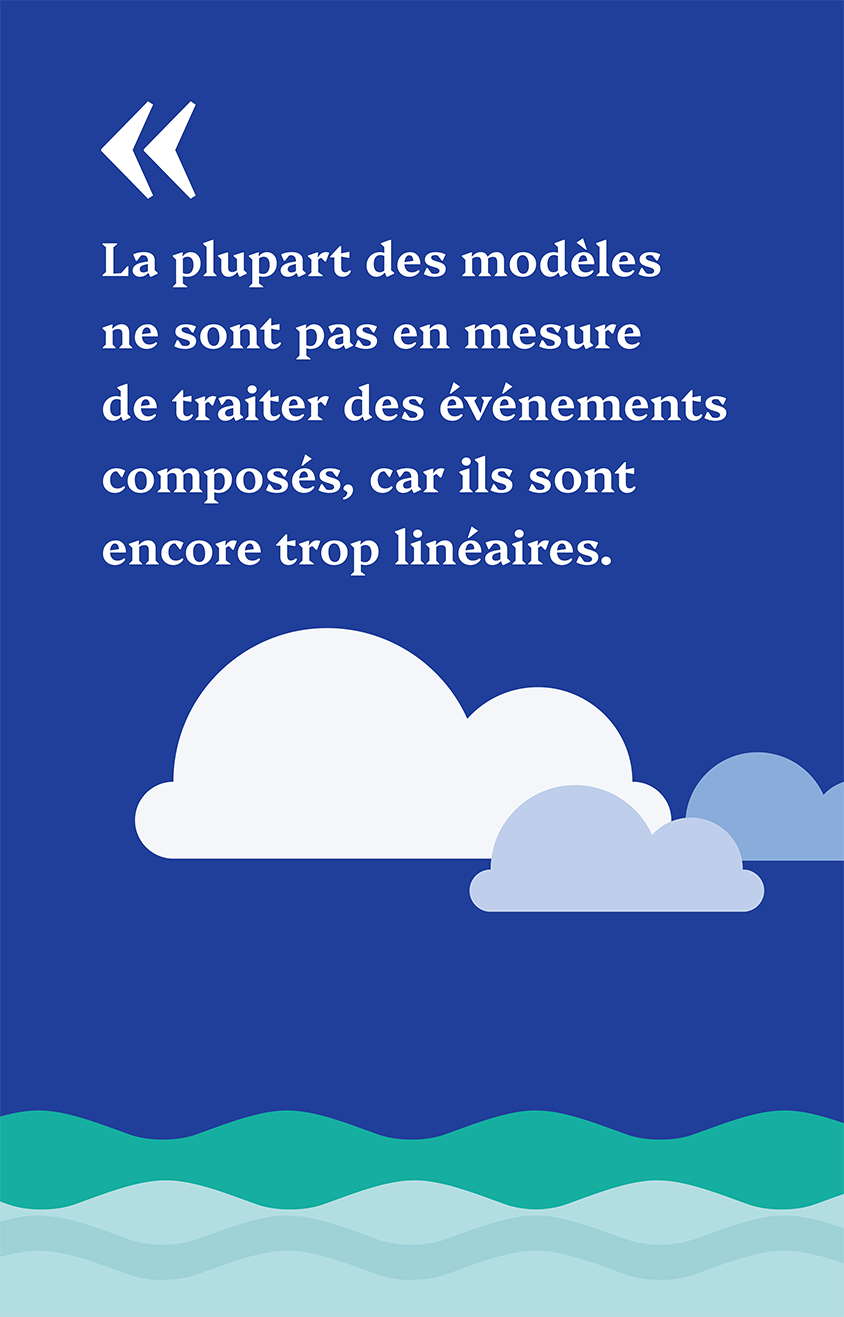
L’un des principaux défis de l’intégration du risque est la disponibilité et la robustesse des données, en particulier pour les actifs pour lesquels les données propres à l’emplacement sont souvent limitées (figure 1). De nombreux modèles ont de la difficulté à saisir avec précision l’importance financière des actifs, en particulier dans les régions ou les secteurs où les risques sont mal compris ou sous-évalués.
Les pratiques actuelles du marché reposent en grande partie sur des scénarios climatiques et des modèles d’évaluation intégrés qui sont « intrinsèquement incertains, en particulier sur des périodes de plusieurs décennies comportant des points de basculement potentiels et des impacts en aval de deuxième ou de troisième ordre. » Un fonds a souligné qu’il existe une « tension inhérente à l’application d’un certain nombre de scénarios pour produire une fourchette de résultats. » Cela offre une perspective générale, mais est difficile à utiliser en pratique. Par ailleurs, un scénario de base est plus facile, mais il « comporte des risques liés à une gestion étroite des risques climatiques du portefeuille. »
Un fonds a fait observer que le NGFS utilise des scénarios assez étroits et linéaires, avec des modèles socioéconomiques obsolètes. Cela signifie qu’ils représentent « un monde très coopératif » qui ne reflète que les changements climatiques et qui n’est donc pas nécessairement précis lorsqu’il s’agit de facteurs de risque plus larges.
Bien que les modèles de risque de catastrophe offrent une solution potentielle, ils sont souvent limités par des sensibilités politiques et ils ont tendance à sous-estimer les risques physiques. Ce problème est particulièrement répandu dans les modèles de simulation de crise utilisés par les banques centrales, qui ont tendance à sous-estimer l’ensemble des répercussions des risques physiques liés au climat.
Un autre obstacle est le décalage entre les horizons temporels des risques physiques et les cycles de placement. Les risques physiques se manifestent habituellement sur de longues périodes et, comme l’a souligné un fonds, « les techniques d’évaluation traditionnelles sont plus susceptibles d’intégrer le risque lié à la politique monétaire à court terme et de sous-estimer le coût du risque physique à long terme. » Cette mauvaise évaluation contribue au risque systémique à long terme sur le marché et rend difficile l’intégration complète des risques physiques à long terme dans les décisions de placement, même si les placements sur les marchés privés, comme les infrastructures, sont moins touchés en raison de leur horizon temporel plus long.
Enfin, l’un des fonds a indiqué que l’adaptation, les paramètres, les évaluations, les plans et les investissements « accusent un retard sur le plan de l’élaboration des politiques, de la faisabilité, du budget et des études de cas, mais qu’ils constituent tout de même un élément important de l’évaluation du risque physique. »
Stratégies d’atténuation
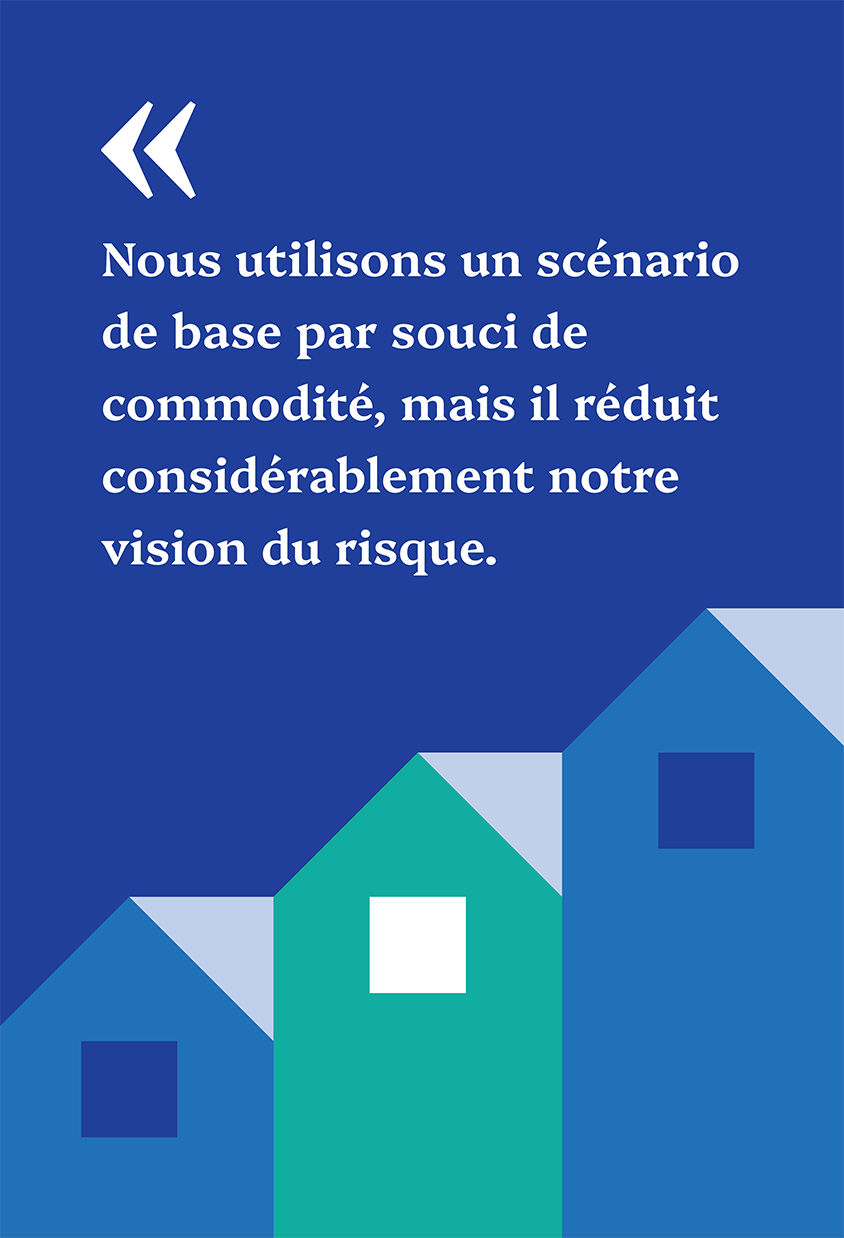
Pour surmonter ces difficultés, les fonds élargissent leur analyse des risques physiques, en particulier pour les actions cotées en bourse et les obligations de sociétés, malgré les limites des données. Certains fonds investissent dans de nouvelles analyses géospatiales et satellitaires du risque climatique afin d’améliorer la granularité des évaluations du risque spécifiques à un lieu. D’autres intègrent des cadres de modélisation des catastrophes pour affiner leurs prévisions d’événements météorologiques extrêmes et leurs répercussions financières. Un fonds de l’Asie-Pacifique a déclaré : « Nous testons activement des modèles de risque de catastrophe pour combler l’écart dans les prévisions de gravité et mieux quantifier les expositions au niveau des actifs. »
La collaboration avec des organismes sectoriels comme le NGFS et l’Agence internationale de l’énergie est devenue une stratégie clé pour améliorer les cadres méthodologiques et l’harmonisation réglementaire. Certains fonds collaborent également plus directement avec les fournisseurs de données et les établissements de recherche pour préconiser l’amélioration des ensembles de données climatiques, en veillant à ce qu’ils tiennent compte à la fois des vulnérabilités directes des actifs et des risques indirects de la chaîne d’approvisionnement.
De nombreux fonds publics peaufinent leurs processus de placement internes et intègrent la modélisation financière ajustée au climat à leur processus de diligence raisonnable. Un fonds nord-américain a déclaré : « Nous travaillons à intégrer des mesures du risque physique lié au climat à notre scénario de base pour nous assurer que les actifs sont évalués correctement en fonction de l’exposition à long terme. » De plus, certains fonds mettent sur pied des équipes internes de gestion du risque climatique pour surveiller l’évolution des exigences réglementaires et s’assurer que les stratégies de placement correspondent aux simulations de crise climatique imposées par les organismes de réglementation financière.
Malgré ces difficultés, les fonds tirent de plus en plus parti de la technologie, de l’engagement réglementaire et de l’amélioration des partenariats en matière de données pour combler les lacunes dans l’évaluation du risque. Même si les méthodes actuelles ne sont pas encore parfaites, ces stratégies d’atténuation constituent une étape importante vers l’intégration du risque physique dans la prise de décisions de placement.
Engagement auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons et des parties prenantes
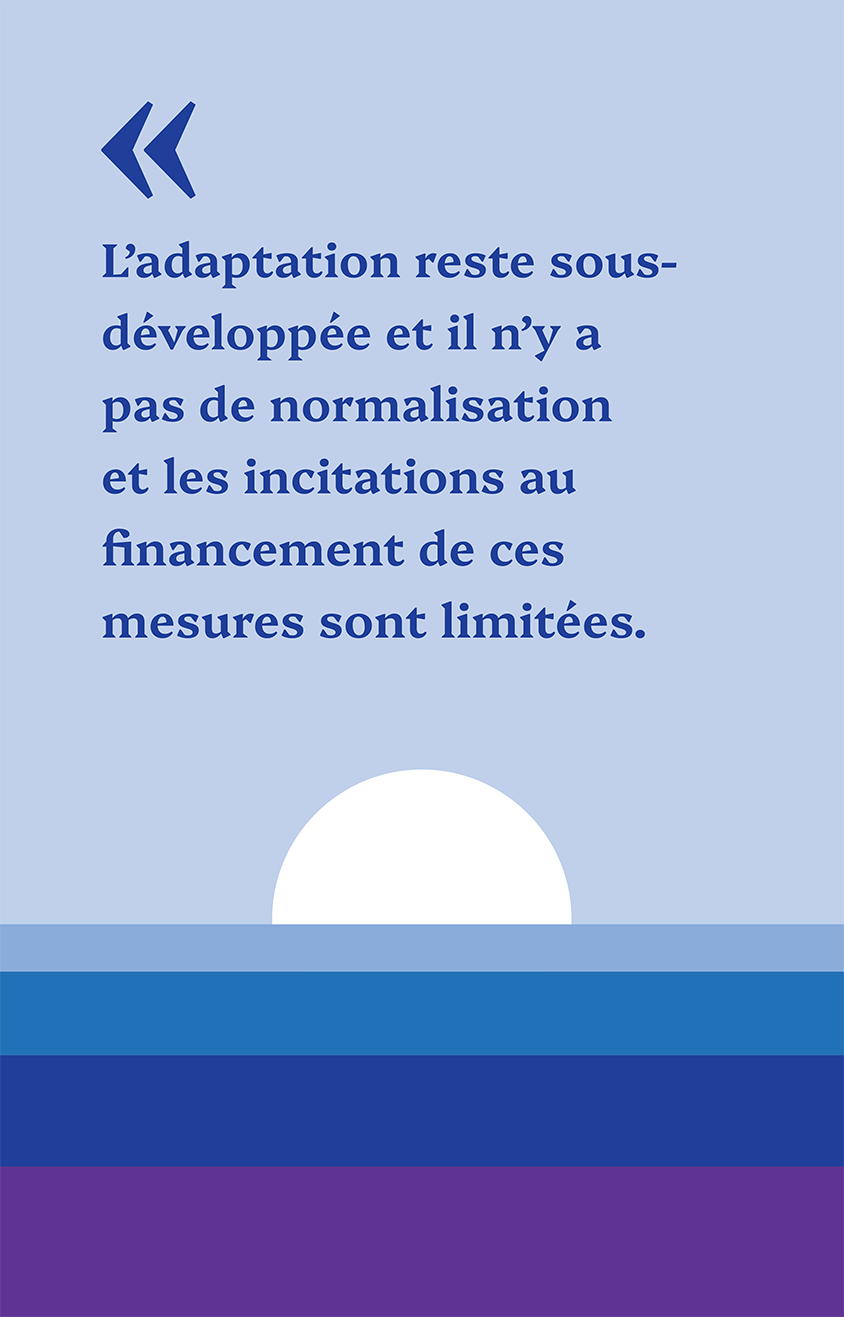
L’engagement auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons est une stratégie cruciale pour gérer les risques physiques, les investisseurs adoptant un éventail d’approches pour s’assurer que les risques climatiques sont bien pris en compte. Certains fonds accordent la priorité aux actifs et aux secteurs à risque élevé afin de les surveiller plus étroitement, en travaillant directement avec des partenaires de capital-investissement et des gestionnaires immobiliers pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation, comme la protection contre les inondations et le renforcement des infrastructures. Un fonds nord-américain a expliqué ce qui suit : « Nous identifions les sociétés dans lesquelles nous investissons en priorité afin de renforcer notre engagement et notre contrôle, en discutant des principaux risques physiques et des processus de gestion du risque au niveau de l’entreprise. »
En plus d’un engagement direct, certains fonds collaborent avec des sociétés d’ingénierie et des spécialistes du climat pour évaluer la résilience physique de leurs placements. D’autres s’appuient sur des stratégies d’engagement et de vote pour faire pression en faveur d’une plus grande divulgation de l’information sur les changements climatiques et de pratiques de gestion du risque. Un fonds de l’Asie-Pacifique a expliqué : « Nous commençons à évaluer les données au niveau des installations pour identifier les vulnérabilités et améliorer les stratégies d’engagement auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons. »
Bien que l’engagement soit plus simple sur les marchés privés, les investisseurs qui gèrent de grands portefeuilles publics diversifiés intègrent des données au niveau des installations dans les évaluations du risque et utilisent des modèles conditionnels de valeur à risque pour mesurer l’exposition.
Occasions de création de valeur dans la résilience au risque physique
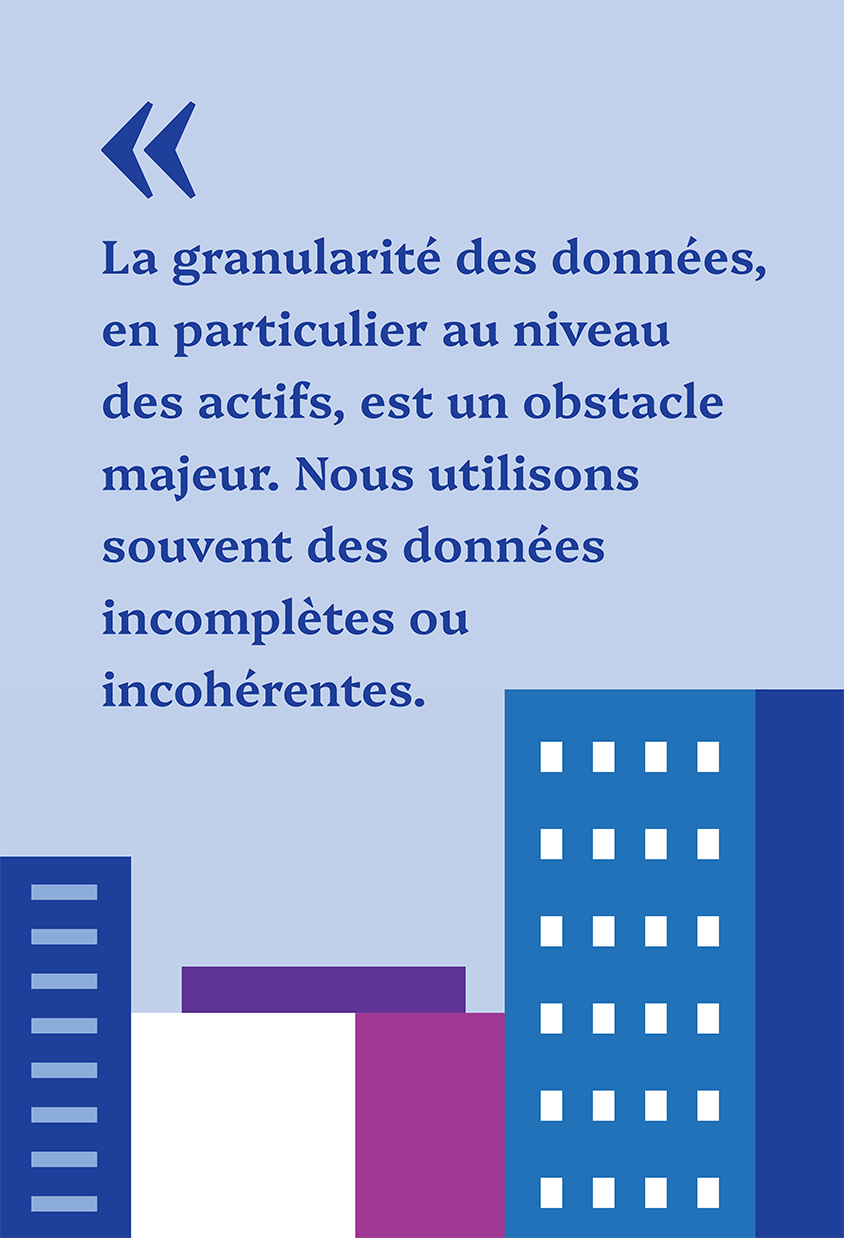
Au-delà de l’atténuation des risques, l’amélioration de la résilience présente des occasions importantes de création de valeur. Certains fonds considèrent les solutions d’adaptation comme une occasion de placement, les secteurs axés sur la résilience climatique, comme les infrastructures de protection contre les inondations, l’immobilier résistant aux feux de forêt et les systèmes de défense côtière, devenant de plus en plus intéressants. Un fonds a souligné que « les investissements dans des mesures d’adaptation, comme les digues au moyen de programmes d’infrastructures publiques, peuvent offrir de la résilience tout en produisant des rendements financiers. »
Les investisseurs qui évaluent et gèrent de façon proactive le risque physique peuvent également obtenir un avantage concurrentiel en identifiant les sociétés les mieux positionnées pour la durabilité à long terme. Comme l’a expliqué un fonds de l’Asie-Pacifique : « L’évaluation de la préparation au risque physique nous permet d’identifier des sociétés mieux positionnées en vue d’une durabilité à long terme, ce qui réduit l’exposition aux actifs délaissés. » Une solide gestion du risque physique peut offrir des avantages sur le plan de l’assurance et du financement, car les sociétés ayant des stratégies d’adaptation claires obtiennent souvent de meilleures modalités d’assurance. De plus, les prix prospectifs de l’assurance pour les risques physiques actuellement non pris en compte pourraient constituer un signal économique précieux, en soulignant comment les investissements d’adaptation peuvent réduire les coûts d’assurance futurs et en présentant leurs avantages sous l’angle des hausses de coûts évitées. Un fonds nord-américain a souligné : « Nous entrevoyons une création de valeur dans la réduction de la vulnérabilité au risque physique, ce qui peut se traduire par de meilleurs flux de trésorerie. »
Conclusion
Bien que l’incidence du risque physique soit reconnue dans diverses catégories d’actifs, son intégration aux décisions de placement est toujours en cours. Grâce à l’amélioration des modèles et des données et à une collaboration accrue, les fonds publics et privés sont mieux outillés pour comprendre et atténuer les répercussions financières des changements climatiques. Toutefois, il est nécessaire de poursuivre le développement de la méthodologie et de la disponibilité des données pour aborder pleinement les risques physiques posés par l’évolution du climat.
Un nombre croissant de fonds font preuve de leadership en intégrant les analyses avancées actuelles des risques climatiques d’aujourd’hui, en perfectionnant les stratégies d’engagement avec les sociétés dans lesquelles elles investissent et en prônant des améliorations à l’échelle du secteur en matière de collecte de données et de transparence. Ces efforts seront essentiels pour s’assurer que les risques physiques sont non seulement compris, mais gérés de façon proactive afin de protéger la résilience à long terme du portefeuille. Loin d’être confiné aux titres individuels, le risque physique non atténué au niveau de l’actif pourrait devenir un risque systémique plutôt qu’un risque spécifique. Cela s’explique par sa capacité à avoir une incidence sur les infrastructures essentielles et les chaînes de valeur ainsi que sur sa transmission potentielle à travers les prix des actifs sur les marchés de l’assurance, ce qui a une incidence sur les bénéfices, les ratios de couverture, la valeur de la garantie et les engagements. Bien que la décarbonisation de l’économie réelle demeure essentielle pour éviter les pires conséquences sur les changements climatiques, il est de plus en plus évident qu’une plus grande quantité de ressources doivent également être consacrées à la compréhension, à l’atténuation et à la détermination du prix exact du risque physique climatique.
À l’avenir, les investisseurs qui intègrent les facteurs de risque climatique à leurs cadres de placement de base seront probablement mieux placés pour composer avec un avenir de plus en plus incertain, en saisissant les occasions qui découlent d’une meilleure résilience tout en atténuant les risques de baisse. De plus, en mettant en lumière les pratiques émergentes mentionnées dans le présent article, nous espérons soutenir un changement plus généralisé du marché, où une meilleure gestion du risque climatique deviendra un facteur de résilience, de création de valeur et, en fin de compte, de meilleurs rendements pour les investisseurs à long terme et leurs bénéficiaires.
Remerciements
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur temps et leurs contributions :
Richard Manley, chef du développement durable, Investissements RPC
Anne-Maree O’Connor, cheffe de l’investissement durable, New Zealand Superfund
Wong De Rui, vice-président principal, Bureau de la durabilité, GICS
Jack Virgin, associé principal, Investissement durable, Soins de santé du Régime de retraite de l’Ontario
Eivind Fliflet, chef de l’équipe environnementale, Participation active, Gestion de placements Norges Bank
À propos de l’OMFIF
Établie à Londres, à Washington et à New York, l’OMFIF est un forum indépendant pour les banques centrales, la politique économique et les investissements publics, une plateforme neutre pour les pratiques exemplaires dans les échanges mondiaux entre le secteur privé et le secteur public. omfif.org
Équipe de projet
Emma McGarthy, responsable de l’institut de politique durable, OMFIF
Yara Aziz, économiste, Institut de politique économique et monétaire, OMFIF
Sarah Moloney, sous-rédactrice en chef, OMFIF
Ophelia Mather, coordonnatrice du marketing, OMFIF
À propos de l’Institut sur les données d’Investissements RPC
L’Institut sur les données d’Investissements RPC propose des mesures concrètes pour les défis les plus pressants auxquels font face les investisseurs à long terme. En s’appuyant sur l’expertise mondiale d’Investissements RPC, l’Institut s’associe à des chefs d’entreprise, à des universitaires et à des groupes de réflexion de premier plan pour publier des recherches à incidence élevée. Il tire également parti de son pouvoir de mobilisation pour déclencher des conversations qui façonnent la stratégie, font progresser l’excellence en matière de placement et stimulent la valeur à long terme, pour le Fonds et l’écosystème de placement dans son ensemble.
investissementsrpc.com/fr/institut-sur-les-donnees/
Équipe de projet
Maria Montero, directrice générale, Bureau du chef du développement durable
Glenn Sim, associé, Création de valeur du portefeuille
Jamy Kallikaden, directrice générale, Conception durable, Gestion globale de fonds
Naomi Powell, première directrice, Institut sur les données d’Investissements RPC
Natalee Strain, première directrice, Communications internes et initiatives stratégiques
Notes de fin
1 Scenarios Portal, Network for Greening the Financial System. Accès en mai 2025.
2 Kotz, Maximilian et coll. L’engagement économique à l’égard des changements climatiques. Nature, avril 2024.
Vous aimeriez en savoir plus sur l’Institut sur les données d’Investissements RPC? Communiquez avec nous à insightsinstitute@cppinvestments.com
En savoir plus sur Investissements RPC
Investir dans les talents, créer de la valeur : le potentiel des femmes de la
Les femmes de la génération Z créent de nouvelles opportunités de création de valeur à long terme, apportant des idées nouvelles, des
Intégrer l’IA et le capital humain
Le présent rapport fournit des suggestions sur la façon dont les investisseurs institutionnels peuvent engager le dialogue avec les
L’IA changera-t-elle tout?
Dans cette édition, nous abordons certaines des tendances qui devraient façonner le paysage des placements au cours des prochains mois.